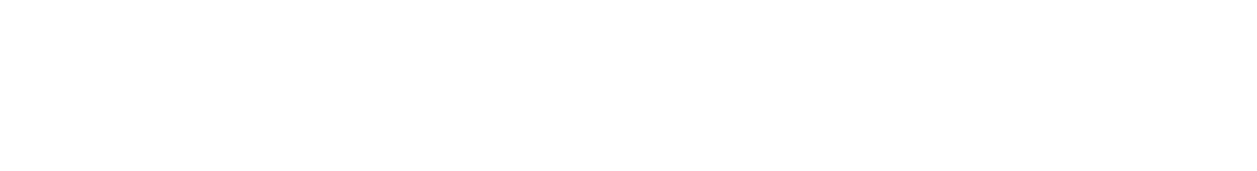« Nous savons que, des civilisations, c’est le périssable qui demeure », écrivait Christian Dior évoquant la mode et « ce que l’on pourrait appeler la beauté qui passe ». Cela résume aussi la vie de cet immense couturier qui meurt à 52 ans, seulement dix ans après la création de sa maison de couture. Dix ans de talent et d’éblouissante fécondité.
Cet homme dont Cecil Beaton disait que « ce Watteau des couturiers contemporains » s’apparentait « à un aimable curé de campagne, en massepain rose » est à la fois un nostalgique du passé et un visionnaire, admirateur du couturier britannique Edward Molyneux et de Mademoiselle Chanel, créateur certes, mais qui n’oublie pas les exigences de la technique ni les caractéristiques de chaque étoffe. Passionné de fleurs et de musique, pudique et discret, timide et modeste malgré son immense succès, il est convaincu que notre civilisation est un luxe qu’il faut défendre.
Il aime rappeler que : « Le couturier propose, mais la femme dispose. »
Et, à ceux qui croient que tout est fantaisie ou caprice dans son métier, il répond, connaissant la responsabilité de celui qui a créé une entreprise :
« À chaque collection, je risque le salaire de neuf cents personnes. »
Enfant gâté de la bourgeoisie provinciale, neveu d’un ministre du Commerce et de l’Industrie, ancien élève, sans diplôme, de Sciences Po, lié aux écrivains, musiciens et peintres de son temps, il ouvre deux galeries d’art contemporain financées par son père, un riche industriel de Granville dont la faillite mettra un terme à cette aventure.
Il devient illustrateur pour Le Figaro, dessinateur de croquis de mode qu’il vend aux maisons de couture, puis modéliste chez Robert Piguet. Maraîcher par obligation pendant quelques mois sur la Côte d’Azur, il est, de 1941 à 1946, styliste, avec son ami Pierre Balmain, chez Lucien Lelong.